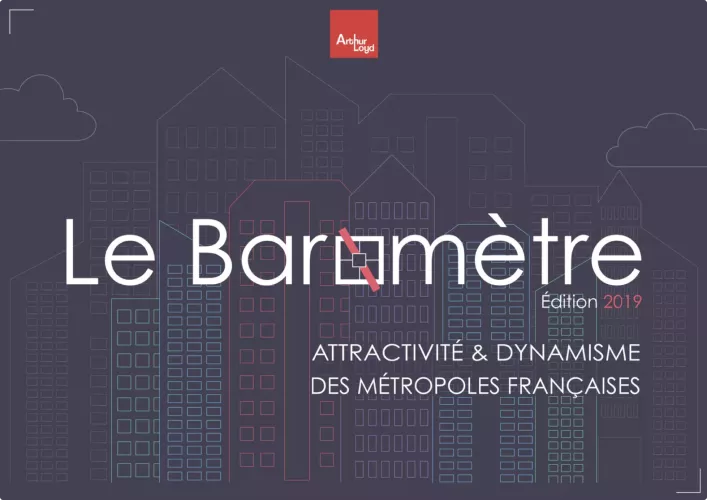Le point de vue de l’expert : Introduction de Nicolas Bouzou
"Les communes jouent un rôle fondamental dans la stimulation du tissu économique local et dans l’accompagnement des grandes mutations du siècle"
Les Français soutiennent leurs maires et ces maires n’en peuvent plus. Avec 60% des Français qui font confiance à leurs élus locaux, ces derniers écrasent tous leurs concurrents politiques. Pourtant, aux prochaines élections municipales, en avril, un maire sur deux ne souhaite pas se représenter. Triste constat pour notre démocratie. Triste constat aussi, et surtout, pour notre économie. Car les communes jouent un rôle fondamental dans la stimulation du tissu économique local et dans l’accompagnement des grandes mutations du siècle.
Un seul chiffre suffit à résumer leur influence : les communes concentrent 53% de l’investissement public hexagonal. Or, pour transformer l’innovation en progrès, il convient d’investir dans les infrastructures, ces dispositifs qui encadrent toute notre économie. Pas de voitures autonomes sans changement de voirie, pas de transition énergétique sans mobilités nouvelles, pas d’économie de la connaissance sans école publique, pas d’innovation sans clusters locaux, pas d’ascension sociale sans rénovation urbaine.
En bref, quand on parle d’avenir local, on parle d’investissement communal. Le constat est valide pour les territoires en déshérence comme pour les grands gagnants de la compétition économique mondiale. Le Baromètre Artur Loyd sur l’attractivité des aires urbaines françaises nous révèle qu’en 2018 les créations d’emploi se sont essoufflées en France et particulièrement dans les espaces ruraux et les zones périurbaines éloignées des métropoles. Il est donc temps de lever le voile sur le rôle majeur joué par les communes dans le développement économique.
Comment nos maires et leurs équipes peuvent-ils développer leur territoire ? Doiton renforcer ou réduire leur autonomie fiscale ? L’action locale se complète-t-elle intelligemment avec la politique nationale ? Les communes jouent un rôle indispensable de chef d’orchestre des projets locaux. Une fonction qui s’exerce dans un cadre en demi-teinte, à la fois propice et défavorable à l’efficacité de leur action. Propice car la règle d’or budgétaire favorise l’investissement au détriment des dépenses de fonctionnement. Défavorable car les services communaux souffrent parfois d’un manque de compétences techniques et doivent investir dans le capital humain.
"L’élu local relie, connecte, compose, propose, guide. Le mythe du maire bâtisseur est déboulonné par celui du maire organisateur"
Tout d’abord, la commune joue la fonction centrale de chef d’orchestre local. Dans les périodes d’innovation et de complexification du monde, la mise en œuvre d’ambitieuses politiques locales repose sur la connexion d’acteurs variés qui n’ont pas l’habitude de travailler ensemble. L’élu local relie, connecte, compose, propose, guide. Le mythe du maire bâtisseur est déboulonné par celui du maire organisateur. Pour construire une économie circulaire, développer des écoquartiers, décarboner les usages, l’élu local joue le rôle de facilitateur et met en musique les techniciens, les financiers, les urbanistes. Les travaux de la sociologue Marie Dégremont-Dorville ont ainsi montré le rôle capital des élus locaux dans les transitions énergétiques territoriales. En théorie, la solution optimale face au réchauffement climatique est l’instauration d’une taxe carbone mondiale. En pratique, c’est l’action quasi-visionnaire des élus locaux qui crée les conditions réelles de la transition.
Ensuite, l’intervention communale bénéfice d’un cadre qui fait rêver de nombreux économistes, la règle d’or budgétaire. Les municipalités ne peuvent s’endetter que pour financer l’investissement. Les dépenses de fonctionnement doivent ainsi être couvertes par les recettes. Ce cadre drastiquement efficace s’inspire des travaux de deux prix Nobel d’économie, Finn Kydland et Edward Prescott. Puisque les acteurs politiques sont soumis à des incohérences temporelles, une décision bonne à court terme ne l’est pas forcément à long terme. Il convient donc de fixer des règles indépassables comme l’autonomie des banques centrales ou la règle d’or budgétaire, le schuldenbremse en allemand.
"L’État central doit urgemment mettre ses compétences à disposition de toutes les communes"
Enfin, et, malheureusement, l’action publique locale pâtit parfois d’une faiblesse de capital humain. Historiquement, en France, les meilleurs connaisseurs des arcanes de la politique économique peuplent les administrations centrales, pas les hôtels de ville. Les grands corps, l’ENA et la haute administration siphonnent les vocations publiques des ingénieurs et des financiers de qualité. La création de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), votée en juillet dernier, est censée pallier le manque d’ingénierie des collectivités les plus fragiles. La logique doit être étendue et l’Etat central mettre urgemment ses compétences à disposition de toutes les communes. Pour que la collectivité soit gagnante dans l’externalisation de la gestion d’un stade, d’une blanchisserie hospitalière, d’un aéroport ou même simplement dans la construction d’une quelconque infrastructure, elle doit investir dans des spécialistes qui mettront la pression sur l’entreprise concernée. La réussite de la collaboration publiqueprivée nécessite des profils de haut-vol dans la collectivité.
"Une commune chef d’orchestre local, encadrée par une règle d’or budgétaire et qui doit investir sur des profils de qualité"
Une commune chef d’orchestre local, encadrée par une règle d’or budgétaire et qui doit investir sur des profils de qualité. Voici la recette de l’action économique locale. Mais pour faire quoi ? Comment créer de la richesse sur un territoire ?
Schématiquement, deux politiques existent : attirer les populations et les entreprises qui résidaient sur d’autres territoires ou faire croître les entreprises et la qualité des emplois déjà présents sur place. La première stratégie est bénéfique localement mais a peu d’intérêt national quand la seconde combine les deux.
Première stratégie donc, attirer des habitants ou des entreprises installés ailleurs. Le territoire d’accueil s’enrichit de la consommation des ménages ou des emplois captés et le territoire de départ s’en appauvrit. Quand un retraité quitte une métropole pour s’installer à la campagne, il s’agit ainsi d’un transfert de valeur, pas d’une création nette. La rationalisation des services publics a incité ces dernières années les communes à mener d’offensives politiques de peuplement pour conserver leur hôpital, leur école, leur caserne.
Seulement, les mairies n’essayaient pas de stimuler le taux de natalité de leur territoire ou d’y améliorer la durée de vie en bonne santé mais plutôt de capter des populations. L’édification de zones pavillonnaires éloignées des bourgs permet par exemple d’attirer de jeunes ménages. Les campagnes de publicité de grandes villes chez leurs voisines visent à attirer les travailleurs les plus mobiles. La concurrence entre territoires peut inviter à innover et c’est une excellente nouvelle. Mais lorsque l’objectif est simplement de capter la valeur présente chez le voisin, l’allocation des moyens devient sousoptimale.
Deuxième stratégie, faire croître les entreprises et la qualité des emplois qui existent déjà sur le territoire. L’ouverture d’espaces de coworking pour créer des effets de réseaux, le développement de filières d’économie circulaire, le soutien à l’innovation et à l’enseignement, l’essor de filières industrielles locales ou encore la labélisation de produits agricoles renforcent l’économie locale sans affaiblir d’autres territoires. Populations et entreprises exogènes suivront peut-être mais l’économie nationale sortira enrichie de la politique locale. Le Baromètre d’attractivité Arthur Loyd nous montre ainsi que c’est la stratégie d’une métropole comme Clermont-Ferrand qui investit sur la connectivité, le capital humain, l’innovation et en retire de belles performances économiques. L’architecture des lois de décentralisation, de la fiscalité locale ou encore des services publics doit tout mettre en œuvre pour que les communes visent cette croissance endogène.
Cette année, le Baromètre Arthur Loyd révèle que les métropoles continuent d’attirer pendant que le tocsin sonne dans certains territoires. Côté emploi, la dynamique est concentrée sur les grandes métropoles régionales (92 000 emplois) et la région parisienne (80 000 emplois) quand le reste de la France pâtit d’un solde bien maigre (33 000 emplois). L’arc ouest – sud-est (de Rennes à Lyon en passant par Bayonne et Toulouse) attire particulièrement les jeunes diplômés. L’analyse selon le degré d’urbanité depuis 2009 révèle la souffrance économique des territoires ruraux et périurbains isolés. Les périphéries proches des métropoles mènent la danse (+8% d’emploi total), suivies des villes centres (+5%) et des couronnes périurbaines (+4%). À l’inverse, les espaces ruraux et périurbains isolés décrochent (-1%). La décroissance est à l’œuvre dans nos campagnes. La crise des gilets jaunes a donné du relief médiatique au phénomène, de nombreux essais sont venus l’analyser et des romans à succès content l’itinéraire de ces territoires.
Alors que faire ? Mener une politique ambitieuse dans les NBIC (nanotechnologie, biotechnologie, informatique et sciences cognitives) pour continuer de créer de la valeur et des emplois dans les métropoles. Et en tirer des bienfaits dans l’industrie, l’agriculture, le tourisme, les services numériques pour raccrocher les territoires délaissés. Pour que la croissance des grandes villes tire le reste du pays, la première exigence est de connecter tous les bourgs de France à la fibre. Les entrepreneurs locaux cesseront de devoir exiler leurs équipes pour grandir. Les travailleurs nomades pourront réellement s’installer aux quatre coins de l’Hexagone.
Le prochain acte de décentralisation, prévu pour 2020, devrait élargir le champ d’action des communes et des intercommunalités sur le transport, l’énergie, le logement. L’accélération des transitions économiques et écologiques locales pourra alors vitaliser les territoires. C’est la stratégie d’une métropole comme Grenoble, d’une communauté de communes rurales comme Le Mené, en Bretagne, de territoires insulaires comme Ouessant, Sein et Molène, ou encore de la région Hauts-de-France. Avec ces nouvelles compétences doivent venir des responsabilités politiques et financières. Politiques via le suffrage universel qui doit être étendu aux présidents d’intercommunalités. Financières via la réforme de la fiscalité locale qui doit aligner les ressources et les actions. Un nouveau pacte de décentralisation deviendra alors possible pour que nos territoires retrouvent le moral. Et leurs maires avec.
Nicolas Bouzou
Économiste & Fondateur d’Asterès